6400 - BÉARN - SOULE
Texte introductif de Christian DESPLAT
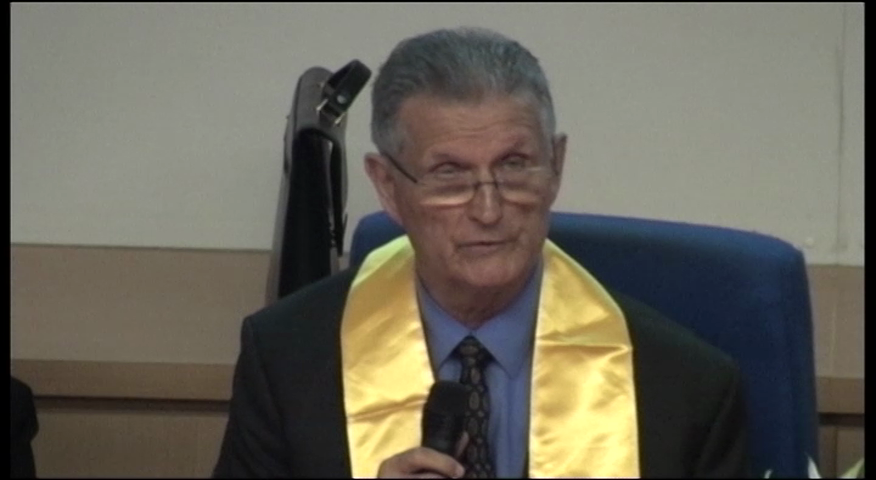
PERSPECTIVES POUR UN HISTORIAL DE LA SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR
« L'honneur est un absolu. Qu'a-t-il de commun avec les docteurs du relatif. »
BERNANOS,
Les grands cimetières sous la lune
« Toute personne d'honneur choisit de perdre plutôt son honneur que de perdre sa conscience ».
MONTAIGNE, Essais, ch. 16
Le 17 février 1800 (25 Pluviôse AN VIII), Napoléon Bonaparte signait la loi créant le Corps préfectoral. En juillet 1801 (Thermidor AN IX), il paraphait le Concordat avec le Saint Siège et le Conseil d'Etat commença aussitôt ma rédaction du Code Civil. Enfin en août 1802 (18 Germinal AN X) le Consulat était proclamé à Notre Dame. Le 1er mars, était créée l'Ecole militaire spéciale (Saint-Cyr). Le 20 mai 1802 une loi promulguait l'institution de l'Ordre de la Légion d'honneur. Les militaires représentés au Corps législatif firent quelques difficultés à cette « mômerie » ! La Légion d'honneur fut votée par 166 voix, contre 110. Que penser de cette avalanche d'institutions dont la plupart subsistent encore aujourd'hui ? Les assemblées révolutionnaires depuis la Nuit du 4 août et la Déclaration universelle des Droits de l'homme et du citoyen avaient supprimé tous les ordres de la monarchie. En créant l'Ordre de la Légion d'honneur, le 1er Consul devenu l'Empereur des Français ouvrait un débat qui dure toujours. En légiférant, Napoléon eut le sentiment , en faisant table rase du passé, de donner à la France des institutions aussi stables que des « masses de granit » pour les siècles à venir. Chaque légionnaire devait « se dévouer au service de la République, de combattre toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal ». Le 15 juillet 1804, le Grand Chancelier déclarait que tout ce qui avait été fait depuis le 14 juillet était irréversible. Le vaisseau de l'Etat est entré dans le port. Il a jeté l'ancre et la Révolution est terminée. Le Grand Chancelier, au mépris du droit des gens fit arrêter et exécuter le duc d'Enghien.
Le message adressé à l'Europe ne pouvait être plus clair : « Tout ce qui a été détruit ne peut point reparaître ». Pour les historiens héritiers des Jacobins, ces masses de granit, ne seraient qu'une entrave à l'achèvement de la Révolution, « à la perfection du bonheur » suivant Saint-Just. Pour les artisans de l'ouvre immense accomplie par la Convention, celle entreprise par le Premier Consul était un obstacle, une trahison.
En instaurant les « masses de granit », Napoléon poursuivait un projet qui, s'il devait aboutir, serait un nouveau monde. Si les mots ont un sens et pour l'Empereur ils en avaient un, il est bon de les entendre. L'ordre, l'ordo latin, était un mot à forte connotation religieuse ; le jour de leur sacre, les rois de France recevaient un ordo pontifical, ils n'étaient pas des prêtres mais accomplissaient des gestes comme tels. La société d'Ancien Régime s'était par ailleurs de siècle en siècle forgée une idéologie : la société trifonctionnelle ; les oratores (les prêtres), les laboratores (les guerriers), les laboratores (ceux qui travaillent). Ces ordres n'impliquaient pas à priori une hiérarchisation, mais plutôt un rangement. Celui-ci aurait été le résultat d'une volonté divine, mais à la fin de la période carolingienne il justifia une hiérarchisation qui fit de l'inégalité de droit la norme sociale. Napoléon, en posant de ses mains la couronne impériale sur sa tête refusait d'être « l'oint du seigneur », mais plutôt le descendant des empereurs romains et il revendiquait pour son ordre le principe d'égalité. Lui donner le nom de Légion n'était pas anodin ; la France et l'Europe se passionnaient pour l'antiquité. Le tableau de David, Le serment des Horaces -qui triomphe au Salon de paris en 1785-, avait fait de la République romaine et de ses soldats-citoyens un modèle insurpassable. Montesquieu, dans ses Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734), avait fait l'éloge de la vertu, fondement de la grandeur républicaine. L'honneur enfin est depuis toujours reconnu comme une valeur universelle. Un Béarnais, Louis Barthou, dont les fils tombèrent au champ d'honneur, en donna une belle définition : « L'honneur, ce n'est pas seulement l'idéologie bourgeoise, l'honneur, c'est l'honneur de tous. Quand on a mis sa signature au bas d'un papier, on est engagé par son devoir et sa conscience, par son honneur. Et heureusement pour cette dignité qui fait la force de la vie humaine et qui lui donne son prix, l'honneur des nations ne diffère pas de l'honneur des individus ». Honneur de soi, certes mais par-dessus tout, honneur : don de soi. Ordre de chevalerie, mais laïcisé, la Légion d'honneur est à la fois l'expression de la démocratisation de la société française, de l'autonomisation de la sphère politique par rapport au sacré et de la liberté de chacun de croire selon sa foi.
DES COHORTES A LA SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR
La Légion d'honneur renvoyait à la Legio romaine, formation militaire des citoyens de l'urbs qui se levaient de leur propre gré pour défendre la patrie, la terre des pères, et qui reprenaient le travail de leurs terres la guerre finie. Par le détour d'une Antiquité recomposée et la création d'une chevalerie des égaux, Napoléon poursuivait un autre projet : réconcilier les Français, forger une société du mérite qui coopère avec la traditionnelle société des élites. C'est dans cette perspective qu'il créa une nouvelle noblesse. Les légionnaires seraient les premiers bénéficiaires de cet ascenseur social, sous réserve toutefois d'avoir les moyens humains et matériels de ces cohortes. Celles-ci devaient représenter tous les mérites et se concrétiser par un maillage social et économique. En mai 1802 il justifia cette institution en décrivant la fragilité du corps social postrévolutionnaire. L'Empereur insista par ailleurs sur le fait que tous les mérites pourraient y donner accès : « En ce qu'il n'existe qu'une seule espèce d'homme parce en conséquence qu'on n'en a pas vu naitre les bottes sur jambes et d'autres avec un bâton sur le dos ». En Floréal an X, le territoire national fut divisé en six cohortes, plus vastes que nos régions. Aux yeux de tous elles montraient la reconnaissance de la Nation envers ceux qui l'avaient bien servie. Leur fonctionnement était en principe assuré sur des dotations des biens nationaux.
Elles offraient aux légionnaires des logements, des hôpitaux. En même temps si l'Empereur y veilla, les lenteurs administratives, les difficultés financières entrainèrent leur disparition le 28 février 1809. Leur fonctionnement ne parvint jamais à être en conformité avec leur mission ; faire des légionnaires les acteurs de la vie sociale et économique dépassait leurs capacités techniques, même s'il y eut quelques belles réussites dans le domaine agricole. Leurs moyens financiers supprimés, le traitement alloué aux légionnaires qui disposaient de biens propres et pouvaient vivre dans une certaine aisance le fut également. Pour ceux qui n'avaient aucun bien, le traitement ne fut que la « rente symbolique ». Finalement dissoutes en 1814, les cohortes pouvaient inspirer des exemples à suivre. Il leur manqua des compétences techniques et la « rente symbolique » était insuffisante.
Une petite fille, dont les parents immigrés sont artisans, me raconte : « Le bonheur c'est quelque chose qu'on reçoit de quelqu'un, alors que l'honneur, c'est quelque-chose qu'on obtient par soi-même. C'est comme si on grandissait. Même si personne ne sait ce qu'on fait, je peux être honorée. L'honneur pour mes parents, ce serait qu'on comprenne qu'ils sont fatigués, sans qu'ils aient besoin de le dire. Comme ils ont le sens de l'honneur, ils peuvent pas le dire ».
Enquête dans une école de Montreuil (Seine-Saint-Denis, 1990).
LA GRANDE GUERRE, MATRICE DES SIECLES SUIVANTS ?
Au cours du XIXème siècle, la population légionnaire s'était peu à peu cantonnée parmi les classes aisées et la « rente » n'avait plus de sens. La Grande Guerre valorisa le courage, le sacrifice et l'unité de la nation dans la défense de la patrie. Entre 1914 et 1930 le nombre des légionnaires doubla parmi les militaires et les simples soldats, issus de milieux modestes formèrent le gros des bataillons de la Légion d'honneur. Revenus de « Là-haut », ils retrouvèrent souvent un foyer vide, leurs champs en friche, leur bétail disparu ? En leur absence le monde avait changé ; « La guerre avait commencé dans l'odeur du fumier, elle s'achevait dans celle du pétrole »! Faute de pouvoir travailler, de moyens financiers pour moderniser leur métier, nombre d'entre eux tombèrent dans la misère.
L'idée de leur venir en aide sans les humilier fut présentée par un officier d'artillerie, employé à la Grande Chancellerie, Jules Renault, au Grand-Chancelier, le Général Auguste Dubail. Les principes du projet de Renault convainquirent aussitôt Dubail : solidarité affective, morale et matérielle. Le Président de la République, Auguste Millerand, approuva le 26 septembre 1921 les premiers statuts et accepta la Présidence de la Société. Le Conseil d'Etat n'apporta que de minimes modifications aux statuts, jugés trop généraux et souhaita que « la Direction et le Contrôle du Grand Chancelier devinssent un haut patronage ». La SMLH fut presque aussitôt reconnue d'utilité publique ; elle eut un double rôle : concourir au prestige de la Légion, assurer la solidarité morale et matérielle de ses membres. S'il est rare aujourd'hui qu'un légionnaire se trouve dans la misère, eux ou leurs ayant droits se trouvent fort démunis lorsqu'il s'agit de remplir des formulaires ou de s'adresser à ceux qui peuvent leur venir en aide. Il est douloureux de rencontrer de braves gens qui se conduisent comme les « pauvres honteux » des siècles passés qui dissimulaient leur misère. Une nouvelle population fait aujourd'hui partie de nos interventions : la jeunesse. Il ne s'agit pas de se substituer à la famille ou aux enseignants, mais de leur faire découvrir leur potentiel et de guider les jeunes dans leur parcours vers le choix qu'ils souhaitent atteindre. Bien d'autres activités veillent à lutter contre la solitude, la désocialisation de nos membres dont les plus âgés sont de plus en plus nombreux.
Ce n'est pas d'être humilié qui est honteux, mais d'appeler l'humiliation honneur.
(Réponse de Jankélévitch[1] à la déclaration du Maréchal Pétain : C'est dans l'honneur que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Vladimir Jankélévitch, Les temps modernes, 1948.
La première démarche de la SMLH fut de dénombrer les légionnaires : 100 000 en 1923, dont 74 000 à titre militaire et 20 000 étrangers, des Africains en majorité. En 1938 : 200 000 légionnaires, 140 000 à titre militaire, 60 000 civils. Notre Historial n'est pas un savant ouvrage, couvert de chiffres, de graphiques, de courbes, de statistiques. Ceux qui l'ont entrepris et mené à bien en ont fait un objet d'utilité publique. Ils ont pieusement recueilli les témoignages des derniers d'entre nous qui connurent les jeunes hommes, qui les armes à la main défendirent la Patrie, mais aussi les savants, les médecins, les entrepreneurs, les sportifs qui ont porté très haut notre Légion d'honneur, celle de nos petites patries et celle de la grande patrie. Notre Historial à la main, le maître d'école pourra entrainer ses élèves à travers la cité et alors les plaques des noms de rue feront revivre tous ceux qui dans leur domaine ont contribué à illustrer ce beau mot de notre devise nationale : FRATERNITE. Chacun d'entre nous leur doit bien quelques minutes d'attention, de réflexion ; celui qui croit en Dieu priera pour eux, celui qui n'y croit pas sera rassuré sur la grandeur de l'homme.
En 1978, lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Soviétiques, Vaclav Havel ne voulait pas désespérer.
« L'absence de héros qui sachent pourquoi ils meurent est le premier pas vers les monceaux de cadavres de ceux qui seront abattus comme du bétail ; ce slogan 'plutôt rouge que mort' m'effraie comme une expression de renoncement de l'homme occidental au sens de la vie. Sans l'horizon du sacrifice suprême, tout sacrifice perd son sens, rien ne vaut rien ».
Vaclav Havel, après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les soviétiques, dans Essais politiques, Paris, Calmann-Lévy, 1989
Lorsque les préhistoriens découvrent des indices qui portent à croire que la guerre existe, sinon depuis toujours, du moins depuis que les hommes se sont organisés en société, aucun conflit ne peut prétendre égaler la Grande Guerre. La Guerre des Gaules, la Guerre de Cent ans, celle de Trente ans, ne peuvent mobiliser des ressources, en argent en hommes, capables de mener le combat à un tel niveau de violences et d'intensité. En retour la Grande Guerre fut un extraordinaire accélérateur de progrès : les "plus lourds que l'air", la téléphonie, la médecine. Mais ces avancées technologiques furent payées au plus fort prix : celui des vies humaines.
Sur le front occidental, la plupart des combattants étaient alphabétisés et purent enfin faire entendre leur voix, même en tenant compte de la censure. La presse, dans un temps très court, en dépit des rumeurs et des « bobards » transformait la perception des événements. La photographie, le film, ajoutaient une forte charge affective à cette proximité entre les combattants et l'arrière. Aucune des principales puissances engagées dans la Grande Guerre ne peut prétendre à ce jour avoir inventorié la masse de documents produite par ce conflit.
Aussi n'est-il pas étonnant que les premiers débats suscités par ces cinq années que Maurice Genevoix qualifiait de « d'indicibles », aient été consacrées non pas nécessairement à la vérité des documents et des témoignages oraux, mais à leur validité. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général américain Samuel Marshall établit le nombre de coups de fusils que chaque soldat américain avait tiré pendant la campagne d'Europe entre 1944 et 1945 ; l'enquête portait sur 400 compagnies d'infanterie, un corpus très suffisant. Le résultat fut plutôt affligeant : 15% des soldats avaient utilisé leurs armes. D'autres recherches confirmèrent et même aggravèrent ce bilan et aboutirent à la thèse de J. Ellis, Brute force, 1990. Mais déjà à cette date, tous ces résultats étaient fondés sur le manque de management de l'armée américaine.
Conclusion : « Considérant ses soldats comme une simple matière première, à l'instar des autres équipements, dont il faut optimiser les flux pour obtenir la victoire uniquement par une simple accumulation ». Cette vision a été reconsidérée depuis 1990 en faveur des GI's[2]. Cependant, un entrainement sommaire fit que nombre de soldats tombèrent sans jamais avoir transgressé le commandement mosaïque : « Non occides ». Dès lors qui approchait au plus près de la vérité historique qui n'est qu'un idéal à poursuivre sans cesse : le statisticien dans son bureau, qui aligne avec froideur les nécessaires bilans d'une offensive, les performances d'une arme nouvelle, ou bien le courrier envoyé par un combattant à sa famille et dont le champ visuel de la bataille n'excède pas quelques mètres ? Ou bien on enfermera dans les disques durs des ordinateurs la mémoire d'hommes qui furent nos grands-pères, qui étaient comme nous des êtres de chair et de sang ? Mais faut-il vraiment choisir entre Jules Michelet et Word ? L'histoire est une discipline littéraire, mais elle a ses exigences de rigueur et de vérité, pour cela il lui faut confronter les documents, n'en négliger aucun. Les rédacteurs de l'Historial se sont trouvés devant un cas heureusement très rare : tous les dossiers de la Chancellerie disparurent dans l'incendie du palais de Salm pendant la Commune en 1870. Ayant cette date, les archives du château de Vincennes permettent toutefois de palier ce déficit. Prenons un exemple récent, celui d'un jeune officier, le lieutenant Heluin ; en 1994 il est au Rwanda et participe à l'opération Turquoise de pacification de la guerre fratricide entre Tutsi et Hutu. Le 6 juillet il découvre une femme et ses six enfants, réfugiés dans une école et menacés de mort par une foule hostile. Seul, il parvient à les exfiltrer. L'année suivante, affecté au 4ème bataillon d'infanterie à Sarajevo il reçoit l'ordre de chasser les Serbes du poste de Verbanja ; il surprend l'adversaire par une véritable charge. Blessé à un ?il, il refuse d'être évacué et achève avec ses hommes de chasser les Serbes ; il reçoit la Légion d'honneur en 1995. Nous aurons sur lui les appréciations de ses supérieurs, celles de ses camarades, le dossier très complet de la Chancellerie, peut-être un jour laissera-t-il son propre témoignage. Mais sur les sentiments de l'homme qui, dans l'instant, risque sa vie au Rwanda, qui entraine ses hommes à Sarajevo, il faudra bien d'autres documents si l'on veut comprendre ses décisions ?
Que dire des pompiers, pour la plupart jeunes bénévoles, qui risquent d'être encerclés par le brasier et périr horriblement ? Que dire encore de la chaine de solidarité qui s'est nouée autour d'eux ? Que serait un peuple qui ne saurait pas reconnaitre ses héros, leur témoigner sa reconnaissance ? A qui ce peuple imputera-t-il sa lâcheté, sa veulerie, ses défaites ? Au Rwanda, un homme seul s'est dressé contre la barbarie criminelle, dans nos si paisibles forêts c'est tout un peuple qui a répondu à l'appel du c?ur qui est aussi celui de l'honneur. En ces journées terribles, des femmes, des hommes de tous âges, de toutes conditions, des civils, des militaires sont librement soumis à cette exigence, le don de soi, qui est aussi la plus belle forme de l'honneur.
LE TEMOIGNAGE DES POILUS : L'AFFAIRE NORMAN CRU
John Norman Dru, fils d'un Français et d'une Anglaise, protestant, est né en Ardèche. Dreyfusard, il enseigne en Angleterre, rejoint l'armée française en aout 1914. Caporal au 240ème RI, Sergent en 1915, passe comme interprète dans la 55ème Division anglaise, et finit la guerre dans la 1ère D.I. US[3], Adjudant. Ses adversaires lui reprochèrent de s'être éloigné du front, sans la moindre preuve. En août 1923, il fit paraitre un ouvrage de 735 pages, Témoins : essai d'analyse et de critique des souvenirs de combattants. Il y présentait une méthode de recoupement des sources, d'identification des lieux et des chronologies. Il parvenait ainsi à sélectionner 300 témoignages fiables. Des auteurs qui connurent un grand succès n'en furent pas moins écartés sans ménagement comme R. Dorgelès ou H. Barbusse. Maladroit et parfois injuste, Norman Cru ne parvint pas à convaincre de la justesse de sa méthode ; la querelle rebondit en 1993 avec la question du consentement, de l'acceptation du combat. Réédité sans une analyse de son contexte, le livre de N. Cru était en porte à faux avec les recherches anthropologiques menées dans le cadre de l'Historial de Péronne, ceux pilotés par Stéphane Audouin-Rouzeau et Annette Becker. N. Cru fut accusé de n'avoir tenu aucun compte du degré de consentement et « sa dénonciation constante des horreurs de la guerre » ne servit pas sa cause par leur redondance. Le débat se poursuivit, en 2003Frédéric Rousseau a rappelé le contexte de l'ouvrage de Norman Cru qu'il ne faut ni encenser, ni diaboliser. Sa méthode de recoupement et d'accumulation des sources est bien celle d'un historien. Par ailleurs le caractère psychorigide de N. Cru a été corrigé par la publication de sa correspondance.
Conclusion : l'expérience de la guerre et de tous les grands drames humains n'est pas réductible à un élément simple. On peut le reprocher à N. Cru, mais on doit tenir compte de l'époque et de l'outillage mental de l'auteur.
TRANSMETTRE NOS CONNAISSANCES : ENSEIGNER L'HISTOIRE SANS LA TRAHIR
La nature et/ou le volume des connaissances scientifiques, la croissance géométrique en nombre et en puissance de l'artillerie, le rôle décisif depuis la Marne de l'aviation, la part de la « Force Noire », la guerre sur mer et la question des convois et sur bien d'autres aspects de la Grande Guerre, l'unanimité, toujours quelque-peu relative, de la communauté historienne s'est faite. Mais permet-elle de conclure à une unité psychologique, morale du combattant de 14-18 ? M. Genevoix en qualifiant l'expérience d'indicible mettait en garde contre toute simplification réductrice. Vous me permettrez de vous soumettre un témoignage personnel que j'ai souvent cité à mes étudiants et pas seulement à propos de la guerre.
Chaque année notre famille se rassemblait à la veille des vendanges chez un grand-oncle, propriétaire d'un grand cru Saint-Emilionnais. Le personnage détonnait quelque peu parmi des hommes et des femmes endimanchés, dans une grande salle à manger, une table couverte de cristaux, de porcelaine. Qu'il garde ce jour là un vieux béret qu'il ne quittait jamais, un gilet constellé de trous de cigarette, ne m'étonnait guère ; on le disait « original ». Ce jour-là un convive se dévouait et posait toujours la même question : « Père, racontez-nous Craonne ». Vieillard encore, il se levait, faisait ouvrir trois de ses meilleures bouteilles, chacune était renvoyée pour un vice imaginaire. Après la première, presque au garde-à-vous et d'une voix forte il annonçait : « On est monté » ; à la seconde la voix moins assurée : « On est redescendu ». A la troisième, la voix devenue sourde : « On est remonté ». Il quittait alors la salle et on ne le revoyait plus de la journée. Bien plus tard, il demanda au jeune professeur que j'étais devenu : « Raconte-moi Craonne, petit ». Je fis de mon mieux : « Tout es vrai dans ton récit, mais vois-tu pour dire Craonne, même ceux qui survécurent comme moi, il faudrait qu'ils en soient revenus ».
A cette époque un nouveau débat agitait les historiens et passionnait le public ; en réalité si beaucoup parmi les premiers s'enflammaient, d'autres étaient découragés. D'un côté, Stéphane Audoin Rouzo et son école soutenaient que pour ne pas mettre bas les armes et fuir un enfer qui n'en finissait pas, il fallait que les combattants adhèrent à un certain consentement. A cette hypothèse s'opposait celle de Frédéric Rousseau : les soldats avaient tenu sous l'effet de la contrainte. Le consentement aurait été le produit du patriotisme, celui des célèbres manuels d'Ernest Lavisse mais aussi l'espoir que cette guerre serait la « Der des Der ». Libérés de celle-ci, on accèderait enfin à un avenir meilleur.
La contrainte disposait des Règlements militaires, ceux de la loi de 1857, complétée en 1875 (Titre II. Livre IV). « C'est l'intimidation que l'on doit avoir en vue, parce qu'elle seule va droit au but et qu'elle seule peut produire de salutaires effets ». Appliquée avec rigueur au début de la guerre, elle le fut ensuite de moins en moins : 202 condamnations en 1914, 130 en 1916, 89 en 1917, 15 en 1918. Les travaux les plus récents tendent à montrer que la contrainte et le consentement n'ont jamais été des attitudes exclusives l'une de l'autre. Elles doivent par ailleurs être étudiées dans le continuum de la guerre et de l'évolution des formes et des conditions du combat. Le consentement parait avoir été général au début de la guerre, qui devait être courte, mais il disparut rapidement avec la société du XIXème siècle et ses rapports marqués par la coercition. Mais aucun officier, aucun gradé n'aurait pu stimuler ces hommes au moment de l'assaut par la seule contrainte. Sans être absolument inutiles, ces débats ont eu une conséquence fâcheuse : la simplification abusive. Ainsi les manuels scolaires mettent en avant le consentement ; les médias, le cinéma en particulier ne retiennent que la contrainte la plus violente. La recherche s'oriente aujourd'hui vers les « groupes primaires », les affinités régionales, la solidarité. Un diplomate belge analysait ainsi le comportement des régiments de réserve après deux ans de tranchées : « Ils étaient formés d'hommes de 41 à 46 ans. Ils résistent et cela est presque incroyable ; ils sont sombrement résignés. Mais il faudrait une ignorance presque choquante pour croire aux récits de certains qui nous les représentent comme pleins de joie à l'idée qu'ils vont mourir et comme désespérés à la seule pensée que la paix par sa venue les empêchera de vivre sous les schrapnells, de coucher dans la boue et d'être dévoré par la vermine ».
La guerre n'épuise pas les chemins qui conduisent à l'honneur. Le créateur de la Légion d'honneur l'avait bien précisé ; l'Ordre devait être le creuset d'une société nouvelle et il veilla à ce qu'elle ne devienne pas un ordre militaire. « Si l'on distinguait des honneurs civils et militaires, on établirait deux ordres tandis qu'il n'y a qu'une Nation. Si l'on décernait des honneurs qu'aux militaires, cette préférence serait pire encore car dès lors la Nation ne serait plus rien. Il n'existe qu'une seule espèce d'homme».
[1] Vladimir Jankélévitch est né en 1903 à Bourges, de parents russes exilés en raison des pogroms antisémites. Entré à l'École normale supérieure en 1922, il en sort premier à l'agrégation de philosophie en 1926 et soutient sa thèse consacrée à Schelling en 1933. Il commence sa carrière de professeur dans différentes villes de France jusqu'à sa révocation en 1940 suite aux lois anti-juives. Il s'engage alors dans la Résistance. En 1951, il accède à la chaire de philosophie morale à la Sorbonne qu'il occupera pendant trente ans. Philosophe engagé dans la cité, il soutient le mouvement étudiant de Mai 68 ; il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Le Je-ne-sais-quoi et le presque-rien (1957), Le Pur et l'Impur (1960), La Musique et l'ineffable (1961), L'Irréversible et la nostalgie (1974). Il décède en 1985 à Paris, à l'âge de 81 ans.
[2] GI est l'abréviation de : Ground Infantry (les fantassins, soldats de l'infanterie)
[3] Elle fut la première unité américaine à combattre en France quand, le 21 octobre 1917, ses 14 500 hommes furent affectés à un secteur du front, près de Toul. Elle participa à la bataille de Cantigny (Somme) du 28 au 31 mai 1918.

